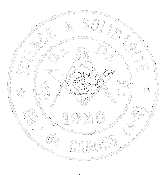Nomadisme, Sédentarité… et Post-modernité
introduction
C’était il y a huit ans déjà William nous gratifiait d’un superbe morceau d’architecture sur le thème « Nomadisme et Sédentarité ».
Ce travail rencontrèrent un tel écho face à mes modestes études sociologiques sur la post-modernité, dans le monde du travail en particulier, que je me promis aussitôt de composer une suite…
Je vous propose donc ce soir une promenade autour de ces thèmes. Je commencerai par une visite de la post-modernité, suivie d’une discussion sur la place de notre Sédentaire et de notre Nomade dans le monde post-moderne…
Autant annoncer la couleur tout de suite – sans révéler le final : je tenterai de rapprocher :
le Sédentaire de la Modernité, et le Nomade de la Post-modernité.
Bien sûr, la tentation de rapprocher des dyades, des oppositions binaires, est toujours périlleuse (une raison, sans doute, de notre préférence assumée ici pour le ternaire ;)… Et j’en appelle à l’indulgence des spécialistes du sujet. : quelques raccourcis ou amalgames manqueront sans doute de rigueur…
Mais j’espère au moins vous convaincre qu’il y a du Nomade dans le Post-moderne…
Mais d’abord, la « post-modernité », qu’est-ce que c’est que ça ?
Serait-ce juste un petit coup de marketing sur l’éternelle « querelle des Anciens et des Modernes », une version 6.0 de la modernité, permettant de ringardiser les utilisateurs de l’ancien modèle ?
En fait, non. Ce terme renvoie à une vraie rupture.
Il est apparu en 1979 dans un petit ouvrage intitulé « La Condition Postmoderne », d’un sociologue nommé Jean-François Lyotard .
Mais au-delà de ce vocable, au contour changeant et connecté à un fourre-tout d’observations contemporaines , le concept renvoie à la « décomposition des Grands Récits », observée par de nombreux auteurs.
Jusques et y compris dans la Modernité, l’homme a en effet appuyé sa vision philosophique et sociale sur des Grands Récits.
On pense bien sûr aux récits des religions monothéistes. Mais la modernité a elle-même enfanté ses Grands Récits.
La Raison des Lumières – celle-là même que nous célébrons souvent ici, et qui a accompagné nos premiers pas – a posé, avec Kant, une « ontologie de la proposition vraie », c’est-à-dire un récit de légitimation à partir d’un référent, de quelque-chose ayant une réalité en soi tout en étant extérieure à l’individu pensant .
Et, partant de cette « Raison », nombre d’entités conceptuelles ont vu le jour comme principes transcendants : pour Hegel, l’Histoire ; pour Husserl, la Conscience ; pour Heidegger, l’Être , etc.
Et des incarnations plus concrètes : l’Etat-Nation (westphalien), le sujet politique, les partis, les professions, les institutions, les traditions historiques et les grands noms, les grands sujets historiques comme le prolétariat, l’émancipation du peuple travailleur, la lutte des classes, etc…
Si l’on ajoute à cela l’obsession taxonomique des Lumières – la science comme classification de tous les objets, des plantes et des petites bêtes jusqu’aux classes sociales des humains, on comprend comment nous nous sommes encombrés de représentations aveuglantes… dont un « post-moderne » dénonce le décalage avec la réalité concrète de la société du quotidien : Peut-on encore observer la société dans son infinie diversité, qui n’entre pas (ou plus) dans les cases que nous imposent ces représentations ?
Par exemple, ici même, pas plus tard que le 3 février dernier , nous avons évoqué avec circonspection les représentations aveuglantes que constituaient « la république », ou « les civilisations »…
A l’opposé, l’individu « post-moderne » se construit sans le support d’entités transcendantes et de grands récits. Hors des cases. Hors des classes. Dans un monde en perpétuelle reconfiguration, où l’infinie combinatoire des jeux de langage s’émancipe des représentations.
J’ai évoqué une multitude d’auteurs remarquant cette décomposition des grands récits, et ce dans de nombreux champs. Quelques exemples :
Dans la littérature, il faut citer Robert Musil et son « Homme sans qualités » (Der Mann ohne Eigenschaften) dont l’écriture commence en 1930 et s’achève avec la mort de Musil en 1942. Son personnage, homme sans qualité au sens de « sans caractéristique sociale » se frotte aux milieux politique, industriel, artistique, scientifique, sans appartenir à aucun, dans une société autrichienne dont les repères se décomposent.
J’en appelle aussi au spécialiste de Camus avec une question : son obsession de « bien nommer » les choses telles qu’elles sont « dans la réalité », et sa méfiance envers les institutions, ne se rejoignent-elles pas dans une salutaire prise de distance vis-à-vis des représentations ?… Un post-moderne qui s’ignore ?
Dans le champ de la philosophie des sciences, je ne résiste pas à l’envie de parler ici de Richard Rorty, figure du pragmatisme américain, dont un recueil de textes fut publié en Français il y a une vingtaine d’années sous le titre… « Science et Solidarité » ! Proche de John Dewey, il cherche à débarrasser une vérité scientifique de sa référence « objective » à une réalité extérieure .
On doit aussi évoquer ici Derrida, dont la « déconstruction » vise à débarrasser la lecture de postulats sous-entendus, de ce qu’il décrit comme « une immobilité fondatrice et une certitude rassurante, elles-mêmes soustraites au jeu ».
Dans un champ plus psychologique, Dany-Robert Dufour, dans son célèbre « L’Art de réduire les têtes », convoque les « noms du père » de Lacan pour décrire un individu post-moderne sommé de se fonder sur lui-même, sans garant métasocial…
Revenons à la sociologie (notre Nomade et notre Sédentaire attendent toujours d’entrer en scène…)
Modernité et post-modernité, dont la première s’appuie sur des récits et des représentations que la seconde nie, renvoient à deux conceptions opposées de la nature du lien social, du rapport au monde, de l’individu , de la diversité.
C’est la même année, en 1858 , que naissent deux précurseurs et fondateurs de la science sociologique. Tous deux d’origine juive, ils vont emprunter des voies opposées.
Le premier, Emile Durkheim, est pénétré de l’idée que la société doit former un « tout organique » structuré par un système normatif ancré et rationalisé, faute de quoi elle cesse d’être une société . « Les passions humaines ne s’arrêtent que devant une puissance morale qu’elles respectent », affirme-t-il . Il abandonnera d’ailleurs sa religion d’origine.
Le second, Georg Simmel, est prussien, et moins connu en France. Il est convaincu que la construction de l’individu, la poursuite de la liberté et de l’objectivité, ne sont possibles qui si l’on fréquente l’étranger, que l’on multiplie et diversifie ses interactions, que l’on étend son groupe de socialisation .
Il n’est pas surprenant que la pensée de Durkheim fonde l’école sociologique française – un pays obnubilé par le statut et l’institution – tandis que celle de Simmel se rapproche de l’échange marchand cher aux pays à tradition protestante .
Mais au-delà de ces magnétismes évidents, on peut avancer que Durkheim théorise une socialisation sédentaire et Simmel une socialisation nomade…
Parmi les sociologues exprimant une pensée positive de la post-modernité, figure en bonne place notre F :. Michel Maffesoli, dont les écrits véhiculent la vision d’une socialisation multiple et tribale, fondée sur l’affinité, une communauté sensible et émotionnelle par opposition aux représentations abstraites de la « raison ». Il éclaire sans relâche le « fossé entre ceux qui vivent et ceux qui disent le monde », et n’hésite pas à qualifier de violence totalitaire l’obstination de la Modernité à codifier, à imposer une « idéologie de la maîtrise », à faire entrer dans le rang, à ne voir la vie que comme elle « devrait être », non comme elle est. On lui doit notamment Éloge de la Raison Sensible (1996), Du Nomadisme – Vagabondages initiatiques (1997), Le temps des Tribus (1988).
Les visions critiques de la « post-modernité » sont, pour faire court, de trois ordres :
1. les analyses à visée économique, qui mettent en avant la parfaite adaptation de la « condition post-moderne » aux caractéristiques du capitalisme occidental de ce début de siècle, ou late capitalism. On trouve souvent ces analyses sous la plume d’auteurs américains de culture marxiste (David Harvey, David Held, Frederic Jameson …).
Il est vrai qu’être performant dans le late capitalism, ce n’est plus faire marcher à la baguette du Taylorisme des bataillons d’ouvriers, c’est disposer de bons petits soldats de la consommation, de main d’œuvre flexible, adaptable et jetable. Ce n’est pas planifier et bâtir sur des temps longs, c’est jouer des coups dans des écosystèmes éphémères qui prétendent au durable en multipliant le périssable.
Ce n’est pas régler scientifiquement les rouages humains des Temps Modernes (si bien nommés !), c’est traire la créativité engraissée à l’émotionnel… Évoquons ces récentes études révélant la performance accrue d’équipes sachant mobiliser une meilleure communication et un meilleur décryptage des états émotionnels …
L’économie du late capitalism favorise les flux, le court terme et l’obsolescence en disqualifiant les modèles « sédentaires » où l’on construisait des villes ou des empires industriels génération après génération.
Le capitalisme classique se méfiait de l’errant ; le late capitalism en fait son carburant.
2. les analyses françaises, généralement fondées sur la nostalgie de la représentation paradisiaque d’une société « organique » perdue, et de ses institutions en ruine (État, grandes entreprises , centrales syndicales, etc.). Pour ces auteurs, pas de société, pas de reconnaissance possible sans institutionnalisation des normes et constitution d’un projet politique collectif qui s’incarne dans l’État .
3. les observations concrètes d’auteurs qui observent les formes sociales en émergence. Je pense notamment à Zygmunt Bauman, auteur d’une série d’ouvrages sur ce qu’il appelle la « modernité liquide » : Liquid modernity (2000), Liquid life (2005), Liquid times (2006). Y sont traitées les questions des fragmentations des parcours de vie, la précarisation dans un monde d’incertitude, mais aussi l’inégalité entre les humains qui accèdent à une « liquidité » choisie, confortable et luxueuse (e.g. parce qu’ils peuvent voyager et consommer) et ceux qui sont enfermés dans un pays ou une culture dont ils n’ont pas les moyens d’éviter les normes et les arbitraires…
Revenons à notre Nomade et notre Sédentaire…
William nous a dit qu’il ne veut pas faire mourir son Nomade…
Et si l’on adoptait une définition plus symbolique ?
Si l’on posait que la mobilité du Nomade n’est pas tant de lieu que de lien social ?
Le Nomade n’est alors plus le SDF, c’est l’homme qui s’adapte à des espaces de socialisation dé-normalisés, devenus mouvants et pluriels : socialisation multiple, identités multiples liées aux rôles multiples que l’individu joue sur des scènes multiples (professionnel le jour, danseur de tango ou franc-maçon le soir, membre d’association rassemblant sur internet les passionnés d’art Sénoufo), parcours fragmentés, personnels ou professionnels, tout au long de l’existence.
Le sédentaire a un statut, est protégé par les structures sociales et les institutions. Le nomade transporte seul sa proposition de valeur, qu’il doit perpétuellement négocier, dans un « commerce des hommes » sans forme fixe, face à des interlocuteurs qui ne lui reconnaissent pas de statut a priori de l’interaction.
Le Nomade exerce un métier, quand le Sédentaire occupe un poste.
Vous avez dit carrières nomades ? Selon Richard Sennett, un jeune américain avec deux ans de collège doit s’attendre à changer onze fois de travail, et au moins trois fois de base de compétences au cours de sa vie professionnelle .
On retrouve bien ici la double dimension de la post-modernité :
1. la liberté, l’émancipation des récits, des représentations, des institutions, et le retour de l’affinitaire et de l’émotionnel ;
2. la précarisation en l’absence de structures sociales et d’institutions garantes des normes, d’un individu emporté par le caprice du flux marchand.
Dufour exprime d’ailleurs pleinement cette dualité par l’oxymore en sous-titre de son ouvrage : « Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme total » .
Quant au Sédentaire, nous dit justement William, il « habite au centre d’une toile rassurante et protectrice d’habitudes, de coutumes de conventions, de lois ».
Pour être rassurante, sa toile lui fait peut-être oublier son caractère vestigial… Le jour où l’édifice autrefois si fier s’écroule en un tas de pierres, il perd tout, et surtout ne comprend pas qu’il dépendait d’un édifice imparfait.
Le Nomade est le loup de la fable, le Sédentaire est le chien …
William, tout en reconnaissant le Nomade comme fondateur de l’humanité, et toujours prodigue de sang nouveau lorsque tarissement et sclérose menacent la sédentarité , affirme néanmoins le triomphe du Sédentaire.
Vraiment ?
Et si l’avantage conféré au nomade ou au sédentaire était cyclique ou contextuel ?
Durkheim lui-même est moins catégorique que William, et pense les sociétés humaines soumises à une loi de va-et-vient entre moments de rassemblement (« état de congrégation ») et de dispersion sur l’ensemble d’un territoire .
La vie des nomades est une « tragique évanescence » . Comme Hector chez Giraudoux, ils peuvent répéter ad infinitum : « Je gagne chaque combat. Mais de chaque victoire l’enjeu s’envole » . Tant qu’ils gagnent…
Les Nomades ont intégré le discours de la précarité, de l’adaptabilité, de l’employabilité. De la prise de risque obligatoire : « to stay put is to be left out ». Il vivent le risque permanent, hors des fantasmes de structures collectives ; leur survie ou leur succès dépend uniquement d’eux-mêmes, leurs seules armes sont l’éducation et le savoir .
Les Sédentaires ont tout investi dans leur position au sein de l’édifice protecteur. Ils ont l’avantage tant que l’édifice tient ; ils peuvent ignorer les flux marchands (ou le feindre), et c’est un luxe. Mais ils perdent tout lorsque l’édifice s’écroule : ils n’ont pas de métier, pas d’identité, plus de statut… Surtout, ils ne comprennent pas. On en rencontre, désemparés comme des orphelins, à cinq ans de la retraite.
Devant les nouvelles nécessités économiques, Nomade comme Sédentaires vivent donc le risque, quoique différemment. Le Nomade ne construit que lui-même – et c’est déjà pas mal ! – et ne peut perdre que sa vie par épuisement… Le Sédentaire mise tout sur le même numéro, peut gagner beaucoup comme tout perdre.
L’avantage autrefois concédé au Sédentaire s’apparente de plus en plus à un casino de l’existence… Ce n’est qu’en connaissant la probabilité d’écroulement du château de cartes qu’on pourrait départager le sort du Nomade et du Sédentaire… Question de conviction aussi sans doute. Mais la réponse n’est sans doute pas aussi évidente qu’il paraissait.
Par ailleurs, nous avons rencontré deux Nomades : l’émancipé et le précarisé.
Le temps est venu de faire connaissance de deux Sédentaires : l’abrité (pour combien de temps ?) et l’enfermé. Pensons avec Bauman à la grosse moitié de l’humanité qui vit dans des pays desquels ils ne pourront jamais s’extraire, faute de visa ; dans des régimes qui ne les laissent pas circuler ou s’exprimer ; dans des cultures qui ne tolèrent pas d’écart de langage. Sédentarité contrainte de l’enfermement, par opposition à la liberté dont nous jouissons.
Dans sa conclusion, William formulait le rêve d’un monde dans lequel Nomade et Sédentaire se réconcilieraient…
J’avance que notre société est aujourd’hui fracturée entre Sédentaires et Nomades : construits sur des représentations sociales orthogonales, ces groupes d’hommes ne peuvent pas se comprendre, et s’ils tentent un dialogue, c’est un dialogue de sourds.
Le Sédentaire ne connaît rien du risque que voit et vit le Nomade. Le Nomade n’entend rien aux valeurs de statut qui structurent l’univers du Sédentaire et sous-tendent son action – en particulier l’action politique, le plus souvent aux mains du Sédentaire, et qu’il perçoit au mieux comme absurde.
Pour illustrer cette incompréhension, attardons-nous un instant sur la nature et le rôle de la loi…
Le mot Nomade s’apparente, nous rappelle William, au grec « la loi ». Une loi que les marins grecs ont fait élaborer « par crainte d’abandonner le pouvoir à ceux qui restaient » . Pour ré-équilibrer les règles du jeu en leur faveur, malgré leur mobilité.
Mais lorsque Durkheim cherche à désigner une société privée des normes universelles d’un tout organique, il forge le terme « anomie », absence de loi. Pour lui, la loi équivaut à la norme du Sédentaire, il n’en imagine pas une pour le Nomade…
Le Sédentaire ne comprend pas comment un lien social peut être construit sans grand récit fondateur, sans structures collectives incarnées dans des institutions. Il affirme sans démordre que la fondation de l’individu sans référent méta-social ne peut conduire qu’à l’individualisme. L’individu renvoyé à soi est-il forcément individualiste ?
C’est à l’opposé de la thèse argumentée par Maffesoli et Lyotard : le premier sous-titre Le Temps des Tribus : « Le déclin de l’individualisme dans les sociétés post-modernes » ; le second énonce cette formule mille fois citée depuis : « Le soi est peu, mais il n’est pas isolé » .
Le débat est ouvert, et la recherche sociologique a du grain à moudre, pour rebâtir une compréhension du lien social dans un monde de plus en plus nomade…
Par ailleurs, le Nomade gagne du terrain – et un réel droit de cité – à la faveur des nouvelles nécessités économiques. Il crée, il produit, il socialise. Mais il n’en peut plus d’être invisible aux yeux du Sédentaire, un sans-statut dans les représentations institutionnalisées.
Un sujet corollaire est donc la question de la reconnaissance de l’individu dans une société post-moderne. Peu d’auteurs ayant abordé le sujet de la reconnaissance ont tenté de le faire sans rattacher celle-ci aux normes et aux institutions.
Au risque de me répéter, je ne suis pas l’apôtre des nouvelles nécessités économiques qui lancent de plus en plus d’humains dans un Nomadisme précarisé ou émancipé… ou les deux.
Mais le fait me paraît indéniable, et le déni – Moderne – me paraît la pire attitude à adopter.
Tout en travaillant sans relâche à approfondir les questions du lien social et de la reconnaissance dans un monde aux grands récits fissurés, profitons de l’opportunité qui nous est donnée de nous débarrasser des oripeaux des représentations sociales en décalage avec la vie, de l’opportunité de construire une communauté ouverte à l’affectif et l’émotionnel, de vivre pleinement, comme nous le propose précisément William, la réinvention et le renouvellement nomades !
J’ai dit.
Ch. D.°. février 2015