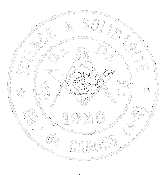Albert Camus ou le don de Liberté, Vérité, Fraternité.
Comment une étanchéité pourrait-elle être possible, ou même souhaitable, entre le travail maçonnique et notre activité profane, sans une sorte de préjudiciable schizophrénie. Cela serait d’autant plus dommageable lorsqu’il s’agit de penser. Personne, parmi nous, ne peut oublier qu’une fois les travaux fermés, nous sommes « colonne vivante » et le portant au-dehors les vérités que nous avons pu acquérir. Ainsi, et c’est là sans doute l’une des dimensions les plus féconde du travail maçonnique, il y a une sorte de circulation entre celui-ci et tout travail extérieur, qui peut à son tour être une nourriture, la matière première de notre réflexion. L’un des mots qui me paraient dire cette « circulation – imprégnation » du sacré par le profane, et vise versa, est celui du don.
Je présente ce travail qui, dans ses prolongements, à chaque mouvement, peut induire une réflexion sur notre travail personnel aussi bien qu’en loge.
Que venons-nous chercher en Maçonnerie ? La lumière, bien sûr, mais quelle lumière ? Celle qui nous vient du soleil, celle que nous renvoient les objets et les êtres ou bien cet espace par lequel elle nous parvient, qu’elle traverse ; le diaphane ? L’exercice de la pensée n’est-il pas autant recherche de la lumière qui peut le mieux éclairer notre monde, élargissement et « purification » de l’espace, de l’air qui lui permette de circuler ? Mallarmé écrivait que le poète « donne un sens plus pur aux mots de la tribu ». Mais la pureté de mots n’est pas sa simplification, sa réduction à un seul sens. Cela, c’est ce que font les tyrannies, les idéologies et toutes les orthodoxies qui commencent toujours par dévaster la langue de ceux qui vont ensuite être asservis. Le bien, le mal, le vrai, le faux, n’ont plus alors qu’un sens étroit et prescripteur. Car le sens d’un mot n’est pas seulement sa signification, mais aussi le mouvement et l’espace de son mouvement.
« Levé avant son sens, un mot nous prodigue la clarté du jour. Un mot qui n’a pas rêvé », écrit René Char.
Il y a ainsi, dans le sens de chaque mot, l’espace et les mouvements potentiels de la pensée. Par là, un mot peut-être aussi ce qui rassemble et qui interroge, un symbole.
À ce titre, le « don » me semble être un foyer de penser et de méditation. Tout d’abord, éloignons-nous du sens monétaire, d’échanges « économiques ». A la question : « Que pensez-vous apporter à la maçonnerie ? », je n’ai pu répondre que : « le mouvement qui m’a conduit vers elle ». Cela ressemblait à une pirouette, mais je trouve encore aujourd’hui pas d’autre réponse. Les moments, les mouvements de la vie profane conduisent à la porte du temple sans que l’on puisse savoir ce que l’on va y recevoir ni ce que l’on va y donner. Si la notion d’échange, dans le sens du « donnant – donnant » est abolie, si je m’engage pourtant, c’est que ceux qui, à cet instant, est essentielle, n’est ni le reçu, ni le donné (c’est-à-dire ce qui est donné ou reçu, mais le mouvement qui reçoit ou qui donne).
Ainsi, « un don qui ne fait que donner son don, en donnant ainsi, se cache et se soustrait ». Dans le pur don, celui qui donne comme ce qui est donné se cachent et se retirent dans le mouvement même. De même peut-il en être ainsi pour celui qui reçoit.
Je voudrais donc vous proposer, après ce long préambule, un exemple de « ramifications » du don que chacun entre nous peut reporter, comme je tente de le faire parfois, dans son propre travail maçonnique.
Je n’ai pas voulu, à chaque instant de ce que je vais vous proposer ici, faire le lien, établir des rapports avec ce que nous travaillons chacun personnellement et collectivement. Cela aurait alourdi et rallongé mon propos. Une seule remarque cependant : nous pouvons, parce que nous sommes entre nous, sans vanité, entendre par la suite dans les mots artiste, créateur, œuvre, le métier, le Mestier, dont nous sommes les perpétuels apprentis.
Chacun d’entre nous peut témoigner de sa rencontre avec une œuvre comme celle d’Albert Camus comme d’une expérience unique et personnelle. Mais il pourrait en être ainsi, aussi pour d’autres artistes. Cependant, l’œuvre de Camus accentue, en quelque sorte, le sentiment d’une véritable rencontre personnelle. Comment exprimer cela ? Peut-être faut-il alors, en pensant par exemple à Proust, montrer à quel point « L’Envers et l’Endroit »ou « Noces » enchantent en même temps qu’ils initient aux chemins qui conduisent à l’écriture et dans la vie.
Je vous propose ici des hypothèses et des réflexions qui, je crois, nous sont communes.
Le don
En français, ce mot a plusieurs sens. Il désigne aussi bien ce que l’on donne que ce que l’on reçoit. Il dit aussi une sorte de capacité presque innée à faire quelque chose. On dit par exemple quelqu’un a un don pour telle ou telle activité. C’est dire qu’il a une capacité, une facilité particulières, différente de la moyenne. Pour recevoir, il faut savoir donner, et réciproquement. Pour cela, il faut avoir un don et le cultiver. Dans la préface à « L’Envers et l’Endroit », Albert Camus dit le premier don qu’il a reçu : « par son seul silence, sa réserve, sa fierté naturelle et sobre, cette famille, qui ne savait même pas lire, m’a donné alors mes plus hautes leçons, qui durent toujours. » De même il insiste sur la richesse du monde, des perceptions simples immédiates, qui empêchent, même au cœur de la pauvreté et de la misère, de céder à l’envie ou à l’amertume. Ce qui est premier, alors, ce n’est ni la culture (qui sera plutôt vécue comme un exil qui exige une fidélité), ni une philosophie ou une religion qui peuvent poser un masque sur le monde. Le don, c’est ce que l’on reçoit, ce qui nous dote et peut, à jamais, faire de nous des êtres doués pour recevoir encore. Ainsi lorsque Camus parle des «leçons de la terre », des leçons du monde dans lequel il est né, il dit autant la lecture de ce monde par l’artiste que la pérennité de ce qui, une fois, a été porté à la conscience et son écriture pour nous.
Mais le don, c’est aussi l’acte de donner, fidèle au don reçu. Ce dernier recèle toute l’exigence de l’artiste dans son œuvre. Dire le monde de la profusion naturelle, de la noblesse des êtres, pour tous, c’est communiquer ce qui, une fois, a été reçu et peut ouvrir le regard du lecteur sur ce qu’il vit lui-même. Il y a là peut-être une définition de la générosité comme capacité à rendre vivants, présents et dynamiques tous les différents sens de l’idée de don. L’artiste tel que le dépeint Camus, notamment dans cette préface à « L’Envers et l’Endroit » est l’homme du don. N’écrit-il pas d’ailleurs « qu’une œuvre d’homme n’est rien d’autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l’art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s’est ouvert. » (Dernier paragraphe de la préface à L’Envers et l’Endroit).
L’entrée dans l’œuvre de Camus par la lecture de « L’Envers et l’Endroit » et par celle de « Noces » est de ce point de vue plus lumineuse. Cette générosité qui sait donner et recevoir, est aussi vigilante dans cette générosité même. Cette vigilance s’ordonne à deux exigences : celle « esthétique » de l’artiste et celle « éthique » de l’homme fidèle à la source de son art. En disant cela, je pense à une Mangala Sutta du bouddhisme Theravada, extraite de Suttanipata, II, 4.
« S’abstenir du mal, renoncer aux intoxicants, être vigilant dans le bien – cela est une grande bénédiction ». « Être vigilant dans le bien »… La formule peut paraître bien étrange, surprenante, voire paradoxale. Et pourtant, c’est bien cette vigilance qui donne toute la valeur de lucidité à la générosité en l’attachant à un amont de son acte. C’est aussi cela qui la préserve d’une sorte « d’ivrognerie du bien » dans laquelle il entre plus de vanité que de compassion.
Ailleurs, dans cette Sutta, il est écrit : « Étant touché par les conditions du monde, demeurer avec un esprit inébranlable, être libre de chagrin, d’attachement et de peine – Cela est une grande bénédiction. ». Un de mes amis bouddhistes me disait un jour que c’était la bénédiction avec laquelle il avait le plus de mal, à cause du chagrin et de l’attachement. Cela pourrait permettre de penser l’engagement camusien en intégrant, avec de grandes précautions, la notion d’indifférence, pivot d’une grande complexité de la « perception-pensée » de Camus. Tout au long de ses engagements, quoique touché par les conditions du monde, Camus resta d’un esprit inébranlable, sur l’essentiel, luttant contre la peur qui crée la servitude.
Ainsi cette générosité qui reçoit et qui donne est elle-même mouvement perpétuel (et non pas agitation), tension toujours lucide et exigeante.
L’artiste qui parle alors de son métier, que ce soit dans des préfaces des textes d’hommage à d’autres écrivains, affirme sans cesse ce chemin qui donne sa valeur et son prix à toute création comme à tout engagement. Comment aller plus loin dans la compréhension de ce don ? Je vous propose ici trois mots en forme de devise : liberté, vérité, fraternité.
Liberté
En ce qui concerne le mot de liberté, nous n’en avons qu’un, en français, alors que l’anglais est mieux doté (Liberty, freedom). Liberté, comme nous le savons, dit, dans sa provenance latine l’affranchissement de l’esclave, libertus. Pour mieux préciser notre pensée il faut peut-être reprendre le chemin du don. Il y a dans le mot de liberté l’idée de lutte pour dépasser un état, se hisser hors de lui ou en être affranchi. Mais il y en a aussi une autre, celle-là éprouvée avant d’être pensée ; celle de la joie d’être, immédiate, le « sentiment de liberté ».
« Il me faut être nu et puis plonger dans la mer encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps terre la mer. », écrit Albert Camus dans « Noces à Tipasa ». Cette liberté du corps n’est pas le fruit d’une lutte mais d’une ouverture au monde. S’éprouver, se sentir dans le monde, partie du monde, découvrir sa « mesure profonde », comme le dit souvent Camus, est la première des libertés. C’est elle alors qui, plus tard, dans l’horreur, au moment où l’inconcevable devient réalité, donne à la lutte les repères éblouissants qui la préservent de la barbarie et la démesure.
L’artiste est un passeur de liberté dans la mesure où il nous permet, par son œuvre, de découvrir, de conduire à la conscience cette liberté que nous portons en nous et que avons parfois éprouvée sans parvenir à la nommer. Une part essentielle de l’œuvre camusienne est là, tout entière dans ce don de liberté qui ne fait pas la morale ni ne crée de contraintes. L’univers dans lequel elle se déploie est celui de la création. L’artiste dans son œuvre dépasse les limites, en invente de nouvelles et assume pleinement le risque de la folie ou du silence. Les repères ne sont plus ceux de ses prédécesseurs. Il invente la forme, la matière de son œuvre. Tout son travail est de tendre vers ces moments rares, cette : « seconde où le sujet se révèle, où l’articulation de l’œuvre se dessine devant la sensibilité soudain clairvoyante, (…) ces moments délicieux où l’imagination se confond tout à fait avec l’intelligence », qui est en quelque sorte une forme d’égrégore. Éprouvons en nous la liberté d’être, accordés au monde et à nous-mêmes, et cette liberté sera toujours lumière, semble dire toujours et partout l’œuvre camusienne. Le travail de l’artiste est une des modalités de cette liberté que chacun porte en lui-même. On peut certes connaître la peur, le découragement mais pas l’amertume ni l’envie qui sont les premiers pas vers la servitude.
Vérité
Cette liberté d’abord vécue, sentie avant d’être pensée et portée par la réflexion, renvoie à l’idée de vérité. Là aussi, le français n’a qu’un seul mot pour le dire, là où d’autres langues en ont plusieurs, aux nuances variées. Je voudrais seulement proposer une piste de reflexion. Celle-ci s’attache particulièrement à la lecture de « L’Étranger ». Dans les dernières lignes du roman, Meursault semble prendre conscience de la vérité de sa vie : « devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. » (Et si les derniers mots du roman appellent à ce que tout soit consommé, Meursault enfin réconcilié, accordé au monde et à lui-même, pourrait dire que cette aube qui l’attend est celle d’un beau jour pour mourir.) Mais de quelle vérité peut-il s’agir ? Toute la première partie du roman nous présente un homme, certes indifférent (quoique la notion d’indifférence soit beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît) mais surtout qui semble vivre à la surface de ces perceptions plus que de ces émotions. Tout se précipite (un peu comme en chimie le précipité se différencie de la solution) dans la seconde partie du roman, lorsque deux conceptions de la vérité se font face : d’un côté, celle de la justice et de l’autre celle de Meursault et de ses témoins. Le monde du procès dans « L’Étranger » est celui d’une rencontre de deux vérités et de la suprématie, du pouvoir de la vérité du jugement et de l’interprétation sur celle de l’appréhension du monde. Il apparaît alors que Meursault est ce que nous pourrions appeler un être « aléthique ». En effet, la vérité, la veritas des Romains a un autre nom dans le monde grec. Il s’agit de l’Aléthéia, de la vérité comme dévoilement qui se retire, mise en lumière immédiate, présence. Il ne s’agit plus de la stricte adéquation de l’intelligence aux choses, mais d’une perception de l’être et du monde dans une sorte de dévoilement. Comment tenter de mieux dire cela ? Peut-être une image pourrait nous aider. Que l’on songe par exemple au ciel bleu d’orage qui pèse sur un paysage, qui donne une lumière et une pénombre à la fois. Au loin, les maisons, les fractures des montagnes se devinent parfois, ou ne se voient pas. Une éclaircie soudain, une trouée de lumière, d’un coup, découpe les formes précisément, donne à voir toutes les nuances de couleurs qui l’instant précédent, étaient encore dans un gris uniforme. Puis les nuages revoilent cette lumière et ce qui fut distingué redevient indistinct. Les Grecs de l’aube de la pensée, entendaient dans l’Aléthéia quelque chose de comparable à ce voilement qui se dévoile et se revoile à nouveau. Dans le monde de Meursault, le vrai est ce qui se dévoile, ce qui apparaît, ce qui est évident, comme le désir, le bonheur, l’indifférence puis se revoile, se résorbe dans une autre « évidence » ou dans l’ennui ou l’indifférence. La vérité est ce qui est « ouvertement présent à l’homme » puis se retire. Une image suffit parfois. Par exemple, dans la préface à L’Envers et l’Endroit, à laquelle il écrit : « cette vieille femme, une mère silencieuse, la pauvreté, la lumière sur les oliviers d’Italie, l’amour solitaire peuplé, tout ce qui témoigne, à mes propres yeux, de la vérité. ». Des images témoignent vraiment, car elles portent en elles une ouverture, un accès à cette vérité, en amont du langage en quelque sorte. Par ailleurs, Camus notait dans ses carnets : « On ne pense que par images. Si tu veux être philosophe, écris des romans. ». Cette vérité qui va de l’image à la pensée ne peut être orthodoxe, ne peut jamais être celle qui ordonne les masses ou embrigade des enfants. Elle revient au monde, aux êtres, à tous ceux qui s’éprouvent en tant que tels dans le don qu’ils reçoivent. L’engagement de l’écrivain se fait au nom de cette vérité qui est à la fois à la source de son œuvre, dans l’exercice de sa création et dans sa fidélité à elle-même. La vérité pour laquelle se bat l’artiste ne peut entrer dans une idéologie ou devenir une auxiliaire de justice sans se renier définitivement. Liberté et vérité apparaissent alors comme les conditions nécessaires de l’art, de l’honneur de l’artiste et de l’authenticité du don.
Fraternité
Mais cela ne serait qu’une liberté ou une vérité du vide, si toutes deux ne se rapportaient pas toutes deux à l’humain. S’éprouver dans le monde, c’est aussi découvrir ce qui fait lien. C’est nouer comme le fait le nageur à Tipasa « sur sa peau », dans son corps les mille fils d’or qui donnent ce sentiment d’une appartenance, d’être soi parmi le monde et les autres. Mais c’est aussi prendre conscience de sa dispersion dans le monde. Dans « Le Vent à Djémila » le narrateur écrit : « Bientôt, répandu aux quatre coins du monde, oublieux, oublié de moi-même, je suis ce vent et dans le vent, ces colonnes et cet arc, ces dalles qui sentent chaud et ses montagnes pâles autour de la ville déserte. Et je n’ai jamais senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde. Le lien, le nœud, qui fait naître la liberté et la vérité devient la matière même de la fraternité. Car tout être humain est d’abord un corps, un corps rattaché au monde par sa liberté d’être, ses sensations et tout ce qui fait sa vie en-decà et en amont de toute pensée. Toujours dans Noces, Albert Camus écrit dans « L’Été à Alger » : « Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu’il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitudes pour une seule vie d’homme. » Certes, comme il l’écrit plus loin, cela ne peut suffire. Cependant, le sentiment d’une communauté humaine peut alors s’étendre à tout être humain. Si l’on veut parler d’un humanisme à propos de la pensée de Camus, il faut le situer à cette sorte de carrefour de conceptions de la liberté, de la vérité qui se nouent au cœur d’une fraternité qui refuse les concepts de l’homme pour s’attacher au corps humain.
Donner, recevoir, apprendre à donner et à recevoir sont nos pratiques quotidiennes. Nous pratiquons cette « générosité » chaque jour, mais souvent portée par l’habitude, la tradition, et tout ce qui pourrait nous faire oublier de vivre ces instants dans une plénitude qui s’accorde à notre être. Alors, le don de la liberté, le don de la vérité, le don de la fraternité renvoient à des expériences fondatrices de l’être.
Ainsi, cet écrivain, ce créateur identifie clairement, pour chacun, la source de son art et la fidélité qu’elle implique. Je lis et je relis, comme on dialogue en amitié avec quelqu’un qui ne fait pas de leçons, qui n’oblige pas, qui permet à chaque instant de savoir ce que l’on a parfois abdiqué et qui en même temps régénère.
De cette amitié j’aimerais dire en citant Camus dans une lettre à René Char, qu’elle est « aussi forte à éprouver que légère à porter. » Ainsi en est-il de la fraternité vraie.
La vie d’un lecteur peut ainsi se passer dans un dialogue perpétuel avec une œuvre sans être pour autant un enfermement dans cette œuvre. Car les rencontres sont nombreuses, les connexions multiples avec d’autres œuvres qui l’ont précédée ou qui l’ont suivie. Une espèce de couronne solaire se constitue alors, éclairant notre temps comme les temps passés, qui ajoute au sentiment de fraternité dans le présent celui d’une fraternité universelle à l’échelle des siècles. N’est-ce pas là la vraie fécondité d’une œuvre d’art qui nous fait entrer dans le mouvement de ce que Malraux appelait « le fleuve mouvant des formes » ?
Je voudrais enfin terminer en vous citant la conclusion d’un texte que Camus écrivit sur le théâtre mais qui, ici peut être, me semble-t-il étendue à toute recherche, à toute pensée.
« Recevoir et donner, n’est-ce pas là le bonheur et la vie enfin innocente (…) ? Mais oui, c’est la vie même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. »
Cannes, le 15 juillet 2014
F PLA